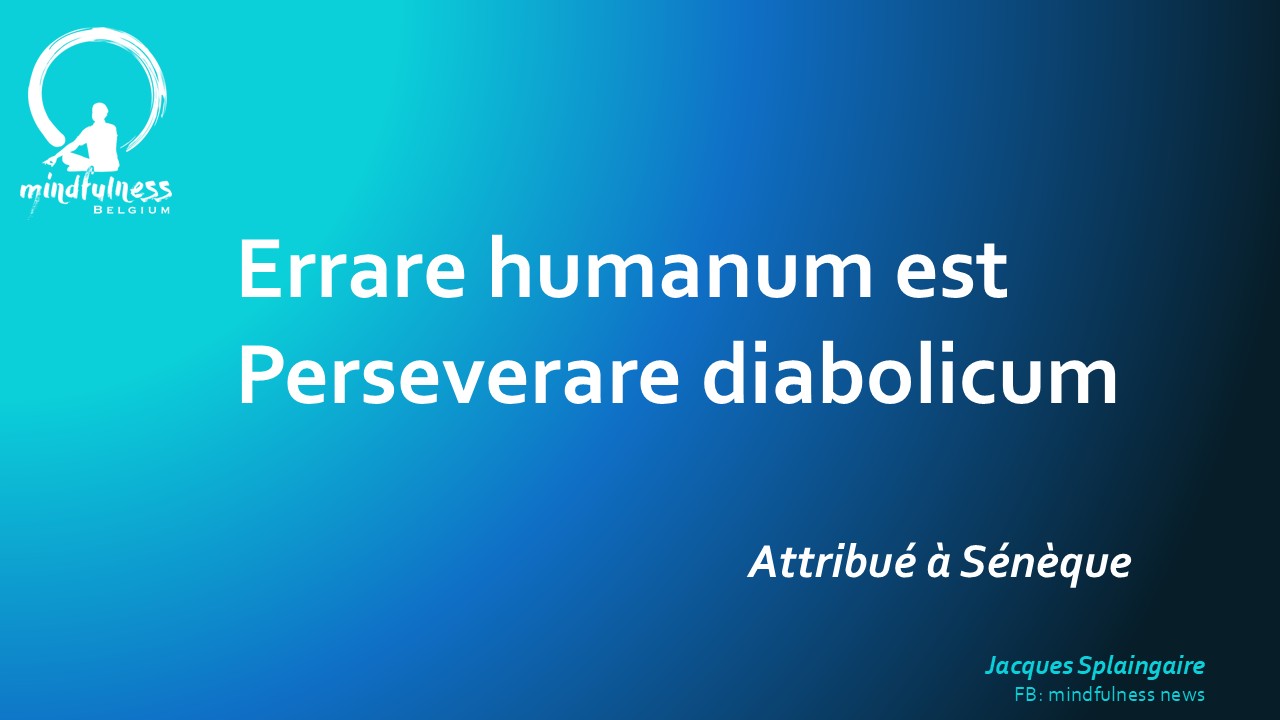
Nous les humains, avons une activité constante … qui consiste à nous tromper.
Nous nous trompons tout le temps !
Par ignorance, par bêtise, par erreur, par préjugé, par humeur, par désir, par peur, par jalousie, par méconnaissance … et surtout par certitude !
Ce texte, je le "ponds" dans le cadre d'un programme d'approfondissement, consacré aux compétences émotionnelles, mais également dans le contexte d'un exemple frappant, qui est le tweet malheureux (c'est un euphémisme) de Nadia Geerts à propos de restaurants "ouverts à Gaza"
Le drame est que nous nous entêtons très souvent dans nos erreurs, le plus fréquemment pour sortir d’une dissonance cognitive (c.a.d. le conflit de loyauté entre deux (ou plus) de nos valeurs), chère à Léon Festinger, qui nous obligerait à dissoudre notre certitude au profit d’un doute.
Nous voulons à tout prix avoir raison, et tout avis nous montrant que nous avons peut-être "moins raison" que nous le pensons, ne fait souvent que renforcer notre certitude.
Les personnes chez qui ce n'est pas le cas sont rares et précieuses.
Nous plongeons alors dans divers biais cognitifs en tentant de nous justifier a posteriori.
Cette tendance à l’auto-justifcation nous amène ainsi à « aménager » notre mémoire, tant à court qu’à long terme.
Le plus « amusant » (façon de parler) est que nous le faisons assez souvent de bonne foi : nous finissons par croire sincèrement à cette histoire reconstruite. Surtout si celle-ci nous dédouane de nos erreurs pour en attribuer la cause à d’autres.
Car pour sortir de cette dissonance cognitive il n’y a presque jamais de solution idéale. Nous plongeons le plus souvent dans une autre.
Et ceci nous amène à craindre de reconnaître nos erreurs ou torts… et surtout à ne pas le faire !
Car dire « j’ai eu tort » après une erreur, peut nous faire croire que cela nous décrédibilise, ou va nous faire condamner par la communauté.
Et le plus « terrible » est que c’est très souvent cas !
L’instinct du blâme, cher à Hans Rosling, porte naturellement les humains à juger et condamner, particulièrement lorsqu’ils sont eux-mêmes dans une situation moralement inconfortable. Et davantage encore lorsque l'instinct de meute tend à les confirmer dans le bien-fondé de leur attitude.
Ensuite, le biais de confirmation va nous amener à ne plus voir que ce qui va dans notre sens (et ignorer ce qui pourrait l’invalider) et, quand on ne trouve plus rien comme argument, à en inventer ou à se lancer dans une attaque ad hominem ou déraper vers une chose n’ayant rien à voir avec le sujet.
La « charité chrétienne », qui fonde nos notions de "bien" , devient alors inquisitoire, et la lapidation sociale suit rapidement, surtout depuis l’avènement de cette gangrène sociétale que nous appelons « réseaux sociaux »
Nous nous transformons alors (toutes proportions gardées) en Talibans … sans assumer ce statut.
Et, tant qu’on en est dans la pensée chrétienne - qui fonde en occident nos notions de bien et de mal - il conviendrait de se remémorer la citation de Saint Augustin Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere. (Ce qui signifie « L'erreur est humaine, mais persister dans celle-ci par orgueil/fougue est diabolique » ), qui prend ainsi un sens davantage moral que celle attribuée à Sénèque.
Dire « Je me suis trompé » ou « j’ai dit une stupidité » , comme le fait Nadia Geerts, sans s’auto-justifier devient ainsi un acte de courage, bien rare et qui devrait plutôt susciter de la bienveillance et de la confiance. Au moins en l’honnêteté de la personne, et non faire soi-même preuve d’une obstination à crucifier celui – ou celle – dont le tort principal est d’avoir dit une chose qui ne nous a pas plu. Car c'est de cela dont il s'agit: je n'aime pas ce que j'ai entendu !
Et il convient aussi de se souvenir que nous ne pouvons pas toujours « réparer » nos erreurs, parce que parfois il n’y a pas de victime, il n’y a que des gens mécontents de ce que l’on a dit parce qu’ils pensent avoir raison.
Or avoir raison est une opinion à propos d’un fait, et non le fait en soi.
Une des intentions de la pratique de la pleine conscience est de nous détacher de ce besoin de certitude, de manière à reconnaître plus aisément nos erreurs ... sans avoir à nous en justifier.